Depuis l’explosion qui a soufflé l’immeuble mitoyen du sien le 1er avril 2016, Gabriel Yared doit composer avec un chantier assourdissant. Adieu la quiétude de sa petite rue du 6e arrondissement. Il a dû se résoudre à voler des heures à la nuit pour travailler en paix. Dans le salon de musique juste assez grand pour son Steinway sont nées les orchestrations des BO de cinq longs-métrages qui sortiront sur les écrans en 2017, dont The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan. Ce sera sa troisième collaboration avec le prodige canadien. Rencontre.
Le Point : Quand votre collaboration avec Xavier Dolan a-t-elle commencé ?
Gabriel Yared : Il m’a appelé pour Tom à la ferme, son quatrième film. Nous ne nous sommes pas rencontrés, nous avons juste parlé deux ou trois fois au téléphone. Il m’a envoyé son film balisé de musiques temporaires. C’est un vrai fléau pour tous les compositeurs aujourd’hui. Comme Xavier écrit ses scénarios en écoutant des musiques, il s’y attache et monte ses scènes en fonction d’elles. Il m’a néanmoins proposé d’écrire ce que je voulais, et ce que je lui ai envoyé lui a plu. Cela prouve qu’il a l’intelligence de dépasser ses habitudes. Et il est fidèle, à part pour Mommy, car il pensait que je n’accepterais pas à cause du petit budget. Là, il se trompait.
L’avez-vous regretté ?
Oui, car on ne rencontre pas souvent des êtres aussi inventifs. Un artiste reconnaît un autre artiste comme son frère, et là comme un petit frère – il a exactement l’âge de mon fils. Pour moi, Xavier est un génie, avec tout ce qu’un génie peut avoir de flambant et en même temps de très tyrannique. Mais je le suis aussi, cela tombe bien !
Et pour Juste la fin du monde ?
Là encore, il avait des musiques en tête et il me demandait une mélodie répétitive, mais ce genre de musique m’ennuie. Sauf dans le cas du boléro de Ravel, à cause de l’orchestration et du crescendo en treize minutes ! Pour l’une des scènes les plus importantes, je suis parti du prélude en do mineur du Clavier bien tempéré de Bach. Il a tourné ensuite immédiatement.
Une partition écrite aide-t-elle le cinéaste ?
Pour qu’il fasse de la BO un véritable outil, il faut qu’il connaisse au moins le thème principal. Plusieurs de mes compositions ont été écrites entièrement avant le tournage. Cela a été le cas de 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix, dont la musique a été diffusée pendant le tournage. Pareil pour Le Patient anglais d’Anthony Minghella, qui a été mon frère d’âme. Avec lui et son monteur Walter Murch, auteur de l’expression sound design, j’ai vraiment progressé.
L’harmonie entre le compositeur et le cinéaste est-elle si rare ?
Moi qui n’étais pas cinéphile quand j’ai commencé ce métier, j’ai découvert les couples que formaient Rota et Fellini, Herrmann et Hitchcock, ou encore Sergio Leone qui a réservé un espace de cinq minutes…sans dialogues à Ennio Morricone, comme dans Il était une fois la révolution. À part Dolan et Minghella, j’ai connu des couples très beaux avec Jean-Jacques Beineix, Jean-Jacques Annaud (césar 1993 de la meilleure musique pour L’Amant) ou Jean-Pierre Mocky. Avec ce dernier, c’est à chaque fois une partie de plaisir.
Comment procédez-vous ?
Je commence par deux ou trois thèmes que je développe avec des variations, des harmonisations. Quand j’ai tous les ingrédients, je porte mon attention sur l’image et je cisèle. Autrefois, les compositeurs visionnaient le film à la table de montage. Un monteur musique donnait les minutages et le compositeur repartait avec le souvenir de l’image. Aujourd’hui, nous sommes obligés de travailler sur l’image en face de nous, sur l’écran d’ordinateur. Or coller à l’image, c’est la desservir.
Les acteurs vous ont-ils parfois inspiré ?
Bien sûr. Par exemple, pour la scène du magasin de pianos de 37°2 le matin, j’ai demandé à Béatrice si elle savait en jouer. Elle m’a répondu : « Que dalle ! » Je lui ai donc écrit une simple gamme qu’elle pouvait jouer d’un doigt pour accompagner Jean-Hugues Anglade, qui est un bon pianiste.
Une autre rencontre déterminante ?
Celle d’Isabelle Adjani pour Camille Claudel. Mais c’est l’exemple qui vient contredire ce que je viens d’énoncer ! Isabelle et Bruno Nuytten venaient de terminer le film lorsqu’ils m’ont contacté. J’ai vu le film. Durée : quatre heures. J’avais trois mois. Je me suis dit « Camille Claudel, c’est Debussy, Ravel, Fauré, les débuts de Mahler ». J’ai donc écrit dans cet esprit, comme une œuvre classique, avec quatre grands thèmes et des développements. On a enregistré à Londres avec un grand orchestre, puis, à Paris, nous avons placé les musiques sur la table de montage. Aujourd’hui, on a l’impression qu’elles ont été écrites pour chaque scène. C’est l’une de mes plus belles expériences. C’est ma musique préférée, la seule que je supporterais d’écouter car je suis maladivement critique de mon travail.
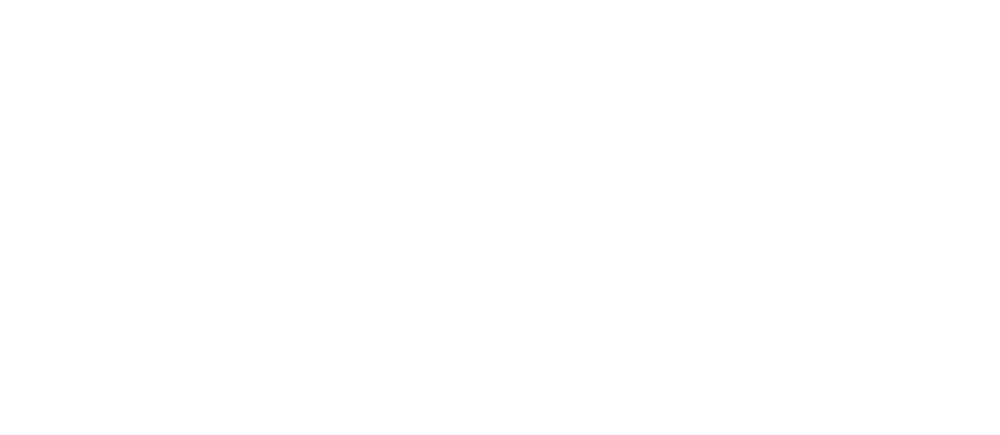
Vous avez reçu un oscar, vous composez outre-Atlantique. Comment expliquez-vous le succès des compositeurs français à Hollywood ?
Nous sommes d’abord des mélodistes, il n’y a qu’à écouter les musiques de Van Parys, Michel Legrand ou Maurice Jarre. Il y a une certaine facture française, pudique, raffinée, cette facture spéciale, sur le plan de l’harmonisation, que l’on retrouve aussi chez Bruno Coulais et Alexandre Desplats.